Tient , tient en 1897 on en parlait déjà ! "
Le Véhicule électrique : promis à
gagner la capitale et à remplacer
la voiture à pétrole en... 1900
En 1897, un chroniqueur scientifique de la revue La Science française, observant l’inquiétante prolifération annoncée des véhicules à pétrole, bruyants et polluants, au sein de la capitale, rassure ses lecteurs en leur présentant comme hautement improbable le fait de généraliser ce moyen de transport, l’estimant d’ores et déjà supplanté par la très prometteuse voiture électrique, dont l’essor inéluctable est à ses yeux imminente. « Etonnamment », cet avènement n’aura pas lieu...
/image%2F1485363%2F20240318%2Fob_5f4746_fp-01.jpg)
Plusieurs grands journaux quotidiens de Paris nous ont annoncé, ces jours derniers, que la capitale allait enfin être dotée de ces fameux fiacres automobiles dont il a été si souvent question depuis plusieurs mois mais dont aucun spécimen n’a été mis jusqu’à ce jour en service régulier à la disposition du public.
Ces mêmes journaux, prenant leurs désirs pour des réalités, annoncent bravement que d’ici peu cinq cents fiacres automobiles seront mis en circulation par les soins de la seule Compagnie générale des Petites Voitures de Paris. Pour peu que d’autres Compagnies de louage aient pris, toute proportion gardée, la même initiative, c’est au bas mot plus d’un millier de sapins automobiles qui muteraient bientôt sur les boulevards.
Que le bon public se rassure, cet événement ne se réalisera pas de sitôt. Pour une bonne raison d’abord, c’est qu’en supposant qu’un type d’automobile ait été définitivement adopté et qu’on pût réquisitionner tous les constructeurs d’automobiles de France et de Navarre, d’Angleterre et d’Amérique pour le mettre sur roues, leur production totale ne fournirait pas d’ici la fin de l’année 1897 les seuls cinq cents fiacres de la Compagnie générale.
Il faut bien se figurer qu’on ne fait pas des automobiles comme on fait des fusils, des montres, et des bicyclettes. On monte et règle, toutes pièces réunies, une bicyclette en quelques heures ; il faut plus d’une semaine pour obtenir ce résultat avec une automobile. D’autre part, si les voitures à moteur à essence minérale font le bonheur du touriste, et, par-ci par-là, celui des magasins de nouveautés, à qui elles servent de réclame, plutôt qu’elles ne rendent réellement service à leurs livraisons à domicile, il faut se pénétrer de cette idée que ces deux types de véhicules ne seront tolérés dans les agglomérations que tant qu’ils seront à l’état d’exception.
Quels qu’aient été les progrès de toute sorte apportés ces temps derniers à la construction de ces automobiles, celles-ci n’en ont pas moins l’inconvénient de faire du bruit et de dégager des odeurs désagréables.
Le jour où des files de véhicules à pétrole feraient la queue aux bifurcations des rues fréquentées, les terrasses des cafés ne seraient plus habitables, les magasins fermeraient leurs portes et les quartiers les plus commerçants de Paris, ceux qui font surtout vivre la grande ville, seraient réduits à fermer boutique, aucune tête ne se montrerait aux fenêtres, ce serait la grève générale des vendeurs, des consommateurs et des locataires.
Nous l’avons dit à plusieurs reprises, la vapeur, jusqu’à nouvel ordre, convient seule aux gros transports, et encore, en parlant des exploits automobiles de la vapeur, ne voyons-nous guère que l’omnibus Weidknecht qui ait fait ses preuves. L’omnibus à pétrole du système Cambier, que nous verrons au concours des gros poids en juillet prochain, lui fera peut-être un heureux pendant. Mais ces types-là sont surtout destinés aux grandes routes : ils ne feront qu’un court séjour dans les villes.
Les voitures électriques sont les seules qui conviennent aux agglomérations populeuses. Celles-là ne dégageront ni fumée, ni odeur, ne feront pas de bruit, s’arrêteront et repartiront sans que le cocher soit tenu de descendre de son siège, et se ravitailleront aux sources d’énergie disséminées à profusion dans tous les quartiers.
Or, il n’existe pas actuellement de voiture électrique légère et économique, mûre pour le trafic des villes. Nous en aurons quelques-unes cet été en essai à Paris, mais si elles donnent des espérances, il n’est pas encore permis de leur prédire le succès à brève échéance. Et en supposant que ce rara avis nous soit bientôt montré, il faudra de longs mois avant que les constructeurs en aient mis des centaines sur le pavé de Paris. M. Pierre Giffard pense qu’il faudra deux ou trois années avant que les automobiles fassent couramment le service de place. Nous ne sommes pas loin d’être de son avis.
/image%2F1485363%2F20240318%2Fob_f55cfe_fp-02-24.jpg)
Donc ce n’est pas au cours de l’an de grâce 1897 que nous assisterons à cette débauche d’automobiles. Et c’est vraiment fâcheux, car le fiacre électrique ferait le bonheur de tous les Parisiens. Ils prendront moitié moins de place que les voitures à chevaux portant le même nombre de personnes, ils iront plus vite, et évolueront plus facilement : tout le monde y trouvera donc son compte, surtout le client, qui fera davantage de chemin et paiera moitié moins cher l’heure, s’il faut en croire les affirmations de M. Rixio, directeur de la Compagnie générale des Petites Voitures.
Ces voitures seront sûrement montées sur pneus : on se croira à Venise, dans les gondoles, tellement l’allure sera douce. La transformation se fera sans douleur, deux ou trois journées d’apprentissage suffisant pour transformer le cocher en excellent chauffeur. Le cheval sera envoyé au vert ou à la boucherie, et le fiacre électrique roulera silencieusement sur le pavé en bois qu’il brûlera sans y mettre le feu.
Restera le piéton, qui aura un nouvel apprentissage à faire, car les tramways mécaniques d’une part, les cyclistes et les automobiles de l’autre, tous filant à qui mieux mieux, lui laisseront difficilement le passage au milieu de tous ces démons déchaînés. C’est là où le bâton du sergent de ville sera d’une réelle utilité. Au besoin on électrisera aussi l’un et l’autre, et il suffira au policeman d’étendre le bras pour arrêter net l’élan des automobilistes lancés dans les passages dangereux.
D’après « La Science française », paru en 1897)
/image%2F1485363%2F20240113%2Fob_696b07_entete-blog-2024-v-4.PNG)
/image%2F1485363%2F20160418%2Fob_1651ec_p1101288-p-b-p-125x150.jpg)
/image%2F1485363%2F20210117%2Fob_bde520_boite-a-lettre-b.PNG)
/image%2F1485363%2F20230105%2Fob_8a30ff_stade-matmut-atlantique.jpg)
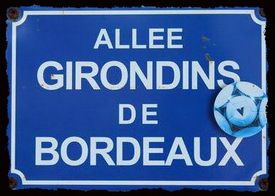




/image%2F1485363%2F20161113%2Fob_b881f5_pb125595.JPG)
/image%2F1485363%2F20150829%2Fob_748ffa_p8247458.JPG)
/idata%2F4168251%2FBillets-.2014%2FArtiste-de-rue%2FP8076340.mtjpg.jpg)
/idata%2F4168251%2FBillets-.2014%2FSarlat-.Cite-Medievale%2FSarlat-00.jpg)
/idata%2F4168251%2FBillets-.2014%2FLes-Jardins-de-Marqueyssac.24220%2FP1260780.JPG)
/idata%2F4168251%2FBillets-.2014%2FCriterium-.Castillon.2014%2FCriterium-.Castillon.2014-0564.R.00JPG.jpg)



/image%2F1485363%2F20240113%2Fob_1526dd_414482270-1731430877356182-91002473594.jpg)


/image%2F1485363%2F20240309%2Fob_549922_affiche-3-m.jpg)
/image%2F1485363%2F20240309%2Fob_64c11a_lescure-02.jpg)
/image%2F1485363%2F20240309%2Fob_fc300a_bgjh4ruccaeflkp-large.jpg)
/image%2F1485363%2F20240309%2Fob_948734_2015-05-09-nantes-adieu-lescure-tifo-s.jpg)
/image%2F1485363%2F20240309%2Fob_1077ae_vlcs2193.jpg)
/image%2F1485363%2F20240309%2Fob_f5fc38_1985-01-0.jpg)
/image%2F1485363%2F20240309%2Fob_85001c_lescure-02.jpg)
/file%2F1485363%2F20240309%2Fob_8be4a9_795757c338e4db3745244e74459a4fdf-png.webp)
/image%2F1485363%2F20240309%2Fob_66c56a_2015-05-09-nantes-adieu-lescure-tifo-s.jpg)
/image%2F1485363%2F20240309%2Fob_183ba6_e180b.jpg)
/image%2F1485363%2F20240309%2Fob_55caea_lescure-0jpg.jpg)
/image%2F1485363%2F20240309%2Fob_1e7fa9_lescure-01n.jpg)
/image%2F1485363%2F20240309%2Fob_dd6c9d_600-2009-chaban-870x489-pimagic-super.jpg)
/image%2F1485363%2F20240309%2Fob_1e88cd_so-5f0edc3066a4bd7972d490cd-ph0.jpg)
/image%2F1485363%2F20240109%2Fob_f04a89_rose-sf.png)
/image%2F1485363%2F20231217%2Fob_922ff4_nestor-burma.jpg)
/image%2F1485363%2F20231205%2Fob_10d565_28059276-618512731824383-5202910643299.jpg)
/image%2F1485363%2F20231205%2Fob_1238e9_pere-et-fils.jpg)
/image%2F1485363%2F20231205%2Fob_7ed827_p-johnny-g.PNG)
