![]() Aujourd'hui....
Aujourd'hui....
Crise de la politesse et
déclin de l’urbanité française
(D’après « Musée universel », paru en 1873)
Rappelant à celles et ceux qui verraient en lui un esprit chagrin prônant le retour à des valeurs tenant de l’ancienne monarchie, que la suprême politesse dans les rapports sociaux nous vient de la démocratie athénienne, un observateur attentif du déclin de l’urbanité française s’émeut, entre autres choses et à la fin du XIXe siècle, de la perte d’une « marque de déférence délicate qui maintenait la femme un peu au-dessus d’un camarade de classe ou de café »
Je ne veux pas dire, d’une façon absolue, que de notre pays ait complètement disparu cette urbanité, cette politesse exquise qui fut, aux deux derniers siècles, une des qualités les plus brillantes et les plus aimables de la société française, explique Frédéric Lock dans le Musée universel en 1873. Il nous en reste encore des débris, plus appréciés peut-être des étrangers que de nous-mêmes, mais une partie notable a péri.
 Peut-être, un jour, quelque chercheur curieux des mœurs d’autrefois ne sera pas fâché de rencontrer ici ces notes sur un sujet que la grande et sérieuse histoire laisse volontiers de côté, n’ayant mission d’enregistrer que les graves événements qui changent la situation des peuples.
Peut-être, un jour, quelque chercheur curieux des mœurs d’autrefois ne sera pas fâché de rencontrer ici ces notes sur un sujet que la grande et sérieuse histoire laisse volontiers de côté, n’ayant mission d’enregistrer que les graves événements qui changent la situation des peuples. Ce que je rappelle ici, je ne l’ai pas observé dans les réceptions de cour ou dans les salons de la noblesse ; c’étaient choses d’un usage courant dans ce que l’on pourrait appeler la moyenne bourgeoisie, si ce mot de bourgeoisie avait encore un sens précis en France.
J’ai pu voir encore, au début de ma jeunesse, des hommes qui, de l’ancienne politesse française, avaient conservé l’habitude de baiser la main à une dame en prenant congé d’elle. C’étaient des vieillards qui accomplissaient avec un respect mêlé d’affection cet acte de courtoisie, accueilli avec une gracieuse dignité par celles à qui il s’adressait.
Depuis, je n’en ai pas revu d’exemple. Au baise-main s’est substitué le serrement de mains, la poignée de mains. Je n’en médis pas : il n’est pas à dédaigner de presser amicalement dans sa main masculine une fine et élégante main féminine, bien que le plaisir ne soit peut-être pas égal pour celle-ci ; mais il y avait dans l’ancien usage une marque de déférence délicate qui maintenait la femme un peu au-dessus d’un camarade de classe ou de café.
Alors aussi, la politesse la plus usuelle n’admettait pas qu’un homme parlant à une femme, quelle qu’elle fût, dans un endroit public, eût le chapeau sur la tête. S’il ne l’ôtait pas par respect pour la femme, il l’ôtait par respect pour lui-même, afin de ne pas donner lieu de penser qu’il pût s’entretenir un instant avec une personne qui ne fût pas digne de cette marque d’égard.
Toujours aussi, un homme se découvrait en entrant dans une boutique (on dit aujourd’hui un magasin) tenue par une femme et ne remettait son chapeau qu’en sortant. C’était aussi le chapeau à la main que, dans les cafés, on s’approchait de la dame de comptoir pour solder sa consommation.
Les Anglais nous ont apporté l’usage d’entrer à peu près partout et de parler aux femmes le chapeau rivé à la tête. Nous aurions pu trouver de meilleures choses à leur emprunter. D’eux aussi vient la coutume, déjà trop répandue, que les dames se retirent à la fin du dîner et s’en aillent causer seules au salon, laissant les hommes boire des liqueurs et fumer pipe ou cigare. Cela a remplacé peu avantageusement le dessert qui était, chez nos pères, le moment joyeux du dîner.
Le tabac n’a pas toujours été ce conquérant despote. J’ai vu le temps où un homme bien élevé n’eût pas osé avoir le cigare à la bouche en donnant le bras à une femme ou en raccompagnant en voiture. Si les femmes se plaignent aujourd’hui d’être chassées par la nicotine, elles ont à se reprocher d’avoir appelé et introduit chez elles cet envahisseur au lieu de le proscrire rigoureusement.
Il y eut, en effet, un moment où la vogue, l’engouement furent tels que des femmes, et du meilleur monde, non seulement tolérèrent le cigare dans la salle à manger, mais encore lui ouvrirent asile dans un fumoir et allèrent jusqu’à fumer elles-mêmes. Elles portent maintenant la peine de leur complaisance outrée.
On dit, il est vrai, que les femmes fument en Espagne. Soit ; cela plaît apparemment aux Espagnols ; mais la mode ne s’en est pas implantée en France, bien que l’on puisse voir, en quelques endroits, des paysannes le bonnet de coton sur la tête et la pipe à la bouche.
C’était encore autrefois une règle de politesse qu’un homme, rencontrant une femme dans un escalier, remontât ou redescendît quelques marches, ou, tout au moins, se rangeât pour lui laisser le passage libre et la saluât quand elle passait près de lui. C’est à peine, aujourd’hui, si l’on prend soin de ne pas la heurter, et elle serait fort étonnée de se voir saluer.
On a dit que le degré de civilisation d’un peuple se peut mesurer à la façon dont les femmes y sont traitées. Faut-il croire qu’en leur témoignant moins de respect, le temps présent leur a fait dans la société une part meilleure. Je laisse à d’autres le soin d’en décider. Qu’en pensent les femmes elles-mêmes ?...
J’ai ouï dire que toutes ces formes de politesse, à peu près oubliées, étaient des habitudes de courtisanerie, nées aux temps de la monarchie et incompatibles avec la liberté d’allures de la démocratie.
Je n’en crois rien. La suprême politesse dans les rapports sociaux, comme le suprême goût dans les choses de l’esprit et de l’art, s’expriment par un mot : Atticisme, qui nous vient de l’époque la plus florissante de la démocratie athénienne. Sommes-nous donc incapables d’être des démocrates aussi polis que les Athéniens du siècle de Périclès ?
Même dans la démocratique Amérique, qui ne se pique pas d’extrêmes raffinements de politesse, la femme est, au moins publiquement, traitée avec beaucoup de respect : la plus timide jeune fille peut aller d’un bout à l’autre des États de l’Union, certaine que pas une parole choquante ne lui sera adressée, et qu’en chemin de fer, si toutes les places sont occupées, un homme se lèvera pour lui céder son siège.
Mais je ne prétends pas faire un sermon ; je n’ai voulu que consigner quelques traits de mœurs qui n’existent plus ; je suis un témoin et non pas un panégyriste du temps passé.
Et j’en terminerai ainsi : « La courtoisie est la partie principale du savoir-vivre, c'est une espèce de charme par où l'on se fait aimer de tout le monde. »
La publication est de :" Grincheux le croquant "
En ce 47ième dimanche de l’année 2011 où le sujet de cet écrit doit emmener à réflexion ?
Question qui en découle ; est ‘il toujours d’actualité ?
Ma réponse tout à fait personnelle est « oui »
C'était, ![]() aujourd'hui.."Crise de la politesse et
aujourd'hui.."Crise de la politesse et
déclin de l’urbanité française"
Bon dimanche …
/image%2F1485363%2F20240113%2Fob_696b07_entete-blog-2024-v-4.PNG)
/image%2F1485363%2F20160418%2Fob_1651ec_p1101288-p-b-p-125x150.jpg)
/image%2F1485363%2F20210117%2Fob_bde520_boite-a-lettre-b.PNG)
/image%2F1485363%2F20230105%2Fob_8a30ff_stade-matmut-atlantique.jpg)
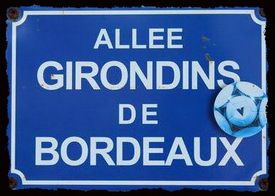




/image%2F1485363%2F20161113%2Fob_b881f5_pb125595.JPG)
/image%2F1485363%2F20150829%2Fob_748ffa_p8247458.JPG)
/idata%2F4168251%2FBillets-.2014%2FArtiste-de-rue%2FP8076340.mtjpg.jpg)
/idata%2F4168251%2FBillets-.2014%2FSarlat-.Cite-Medievale%2FSarlat-00.jpg)
/idata%2F4168251%2FBillets-.2014%2FLes-Jardins-de-Marqueyssac.24220%2FP1260780.JPG)
/idata%2F4168251%2FBillets-.2014%2FCriterium-.Castillon.2014%2FCriterium-.Castillon.2014-0564.R.00JPG.jpg)



/image%2F1485363%2F20240113%2Fob_1526dd_414482270-1731430877356182-91002473594.jpg)


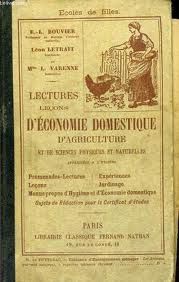 1. Régler sa dépense sur ses revenus et sur son état, sans jamais se laisser emporter au-delà des bornes d’une honnête bienséance par la coutume et l’exemple, dont le luxe ne manque pas de se prévaloir.
1. Régler sa dépense sur ses revenus et sur son état, sans jamais se laisser emporter au-delà des bornes d’une honnête bienséance par la coutume et l’exemple, dont le luxe ne manque pas de se prévaloir. Car la maladie de nos temps, c’est la Ville. Elle travaille la jeunesse des provinces. Endémique, l’amour d’aller au Centre se propage dans tous les êtres jeunes et doués de quelque énergie. Le contagieux microbe s’inocule d’un esprit à l’autre, envahit la race, et toute force se tourne vers le même point : Paris. L’ambition individuelle s’est substituée à l’ambition commune, l’effort solitaire
Car la maladie de nos temps, c’est la Ville. Elle travaille la jeunesse des provinces. Endémique, l’amour d’aller au Centre se propage dans tous les êtres jeunes et doués de quelque énergie. Le contagieux microbe s’inocule d’un esprit à l’autre, envahit la race, et toute force se tourne vers le même point : Paris. L’ambition individuelle s’est substituée à l’ambition commune, l’effort solitaire S’il avait labouré le champ que nul ne laboure pendant qu’il s’en vient par les villes, pour maigre que fût la glèbe, pour mince que fût la récolte, il aurait pris souci du vent et de la pluie au ciel plus que des empereurs et des rois sur leurs trônes. Sa vie peut-être eût été chiche, mais n’eût pas été folle ; peut-être elle se fût écoulée dans une misère traversée d’espérances, mais non dans une douleur lancinée de désespoirs qui unit par aboutir au crime.
S’il avait labouré le champ que nul ne laboure pendant qu’il s’en vient par les villes, pour maigre que fût la glèbe, pour mince que fût la récolte, il aurait pris souci du vent et de la pluie au ciel plus que des empereurs et des rois sur leurs trônes. Sa vie peut-être eût été chiche, mais n’eût pas été folle ; peut-être elle se fût écoulée dans une misère traversée d’espérances, mais non dans une douleur lancinée de désespoirs qui unit par aboutir au crime.


